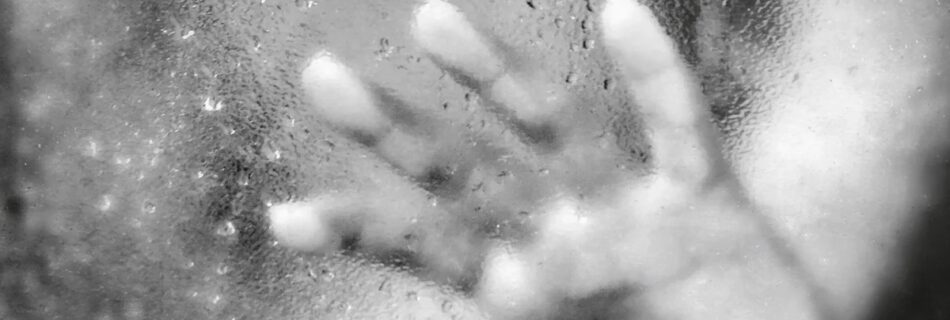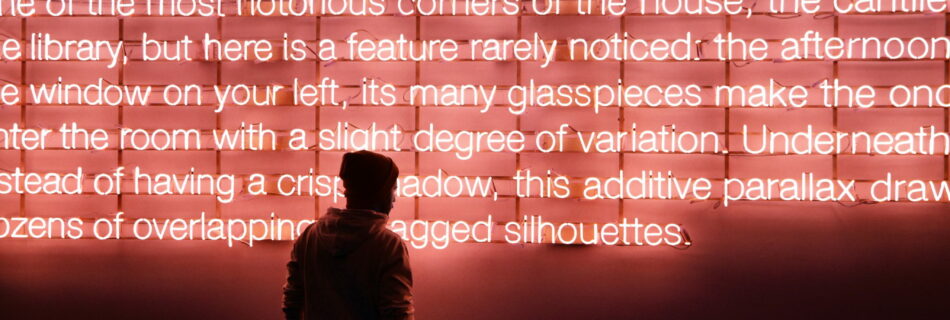histoire de graines
carnet d’installation | 1er octobre 2023 La plupart des végétaux sont parvenus à maturité en ce début d’automne. Temps de rassembler les graines, quelque chose qu’on ressent, non pas dicté par le calendrier mais par le sang. Le jardin encore beau m’en donne envie et je m’y applique avec le sentiment d’aider la nature. Les …