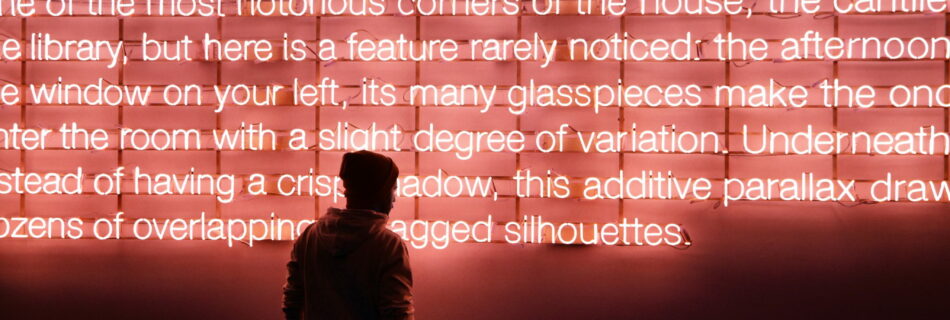vies minuscules
Je savais qu’il était né dans ce pays et qu’il habitait la ville, du moins qu’il y avait habité à une époque, des faits bien loin de ma pensée en ce jour mouvementé de juillet où je parcourais les rues en compagnie d’un couple d’amis venus me rendre visite. Depuis le remarquable édifice du lycée …