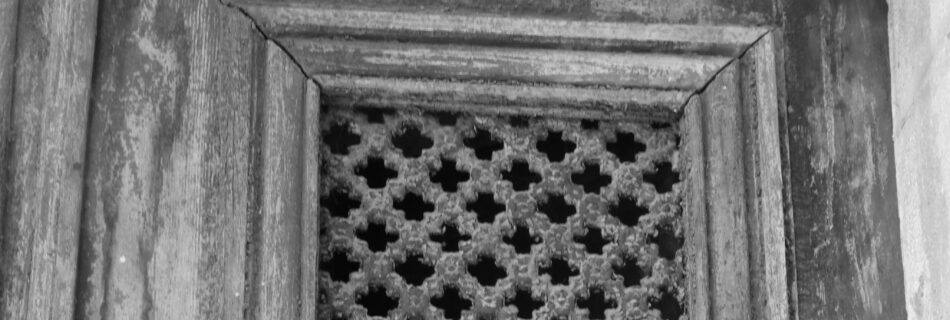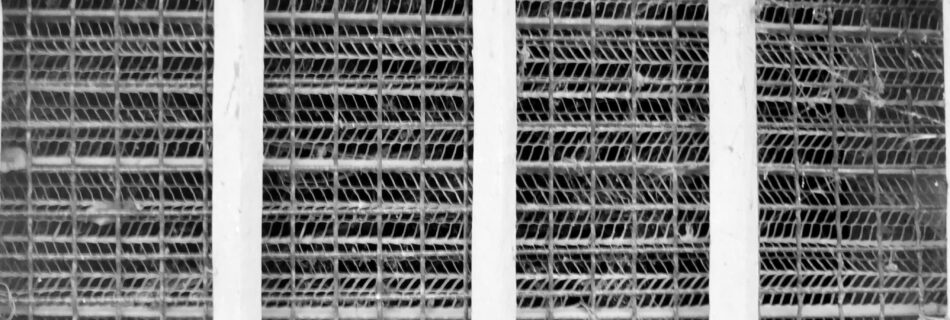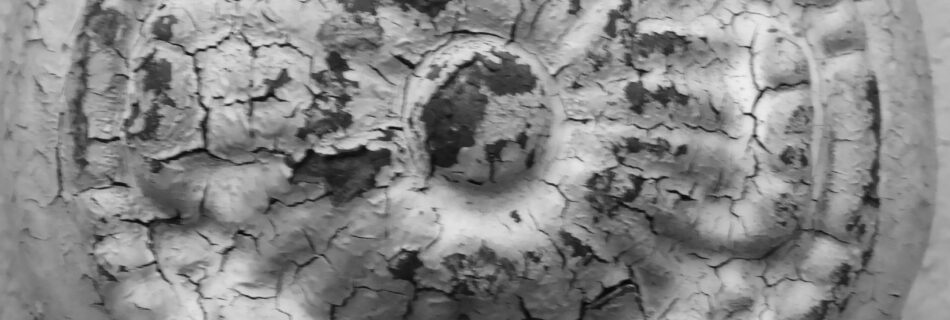tout un été d’écriture #34 | est
Que dire de l’Est ? Zone du levant. Zone de froid avant la lumière. Zone de brume grise et blanche et rose. Point où le monde revient à lui chaque matin. Mais non elle n’a jamais été attirée. Les quartiers Est et tout ce qui s’enchaîne au-delà ressemble à un no man’s land, un territoire …